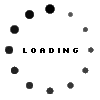Basée à Ouagadougou, la « Saisonnière » est une association qui œuvre pour l’autonomisation économique des femmes, depuis 2003. Grâce aux activités de jardinage qu’elle mène, plusieurs femmes ont pu sortir de la précarité. Dans cet entretien accordé à Queen Mafa, la fondatrice , Salamata Sophie Sedego Hema dévoile les résultats engrangés en matière d’autonomisation financière des femmes.
Qu’est-ce qui vous a motivée à créer une association de femmes pour promouvoir l’agriculture biologique ?
J’ai enseigné dans les lycées et collèges de la 6e à la terminale dans les disciplines scientifiques notamment en sciences naturelles pendant une trentaine d’années. Quand je suis allée à la retraite, je me suis dit qu’il fallait mettre en place une association de femme pour celles qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école.
Au départ, nous avons travaillé dans la transformation des produits de notre pays notamment le mil, le petit mil, le néré, le savon, sous forme de groupement.
Je n’étais pas à Ouaga, j’étais dans des villages environnants tels que Niou, Sabtouana. Quelques temps après, j’ai eu l’opportunité de travailler dans ce quartier avec une ONG dénommée « Voix de femmes » dont j’ai été la coordonnatrice d’un projet.
C’est ainsi que lors de nos sorties de sensibilisations contre les mutilations génitales féminines et contre le SIDA, les gens du quartier m’ont interpellé pour savoir si on ne pouvait pas trouver du travail pour les femmes. C’est ainsi que nous sommes allées à la mairie et le maire en son temps nous a attribuées un espace et un forage pour le jardin.
Mon association a été créée sous forme de groupement en 2003 avec des femmes vulnérables. Ce sont des femmes qui n’avaient pas d’activités qui leur permettaient d’avoir de l’argent. Dans cette extrême pauvreté, certaines raclaient les gravions de sable pour vendre et pouvoir faire face à certaines dépenses.

En 20 ans d’existence, quels résultats avez-vous engrangés en matière d’autonomisation financière des femmes ?
Au départ, nous avons démarré avec l’accompagnement des partenaires. Mais, actuellement nous n’avons pas de bailleur de fonds. Lorsqu’il y a une panne, nous cotisons entre femmes pour résoudre le problème. Je ne peux pas dire qu’on est autonome mais on tend vers l’autonomie et les femmes sont assez épanouies. L’impact est là, elles scolarisent leurs enfants, notamment les filles.
Lire aussi : Zoom sur le REPAFER, une unité d’action au profit de la promotion des droits des femmes
Certaines femmes ont pu s’acheter des moyens de déplacement tels que des vélos, des motos. Il y a eu des progrès parce qu’en 2012, nous avons organisé les femmes pour qu’elles prennent des crédits à la caisse populaire, elles y sont allées, elles ont eu les crédits et elles ont démarré avec des petites sommes de 25 000 F CFA.
Mais, aujourd’hui, il y a des femmes ici qui peuvent prendre des crédits jusqu’à 500 000F pour développer d’autres activités.
En 2017, votre association a été certifiée BioSPG par le CNABio. Qu’est-ce que cette certification vous a apportées ?
Cette certification nous a apportées beaucoup de visibilité. Ça nous a attirées beaucoup de clients. Le BioSPG nous a permis de développer la commercialisation de ce que nous produisons.

En quoi est-ce que vos pratiques culturales diffèrent des autres producteurs conventionnels ?
Nous n’avons pas commencé avec les produits bio. Comme tout le monde, nous aussi, nous faisions le conventionnel. On utilisait l’urée, le NPK, des pesticides. Nous avons donc utilisé ces produits à outrance. Mais très vite, notre sol s’est asséché et rien ne poussait ici.
L’utilisation des pesticides a failli nous faire perdre le terrain parce que généralement, c’était le soir que nous mettions le produit. Pendant la nuit, les riverains n’arrivaient pas à dormir, ils toussaient, il y avait des maladies pulmonaires. Les femmes même d’ici étaient malades et le sol s’est complètement dégradé.
Au regard de tout cela, nous nous sommes dits qu’il faut changer en utilisant dorénavant la fumure organique. Mais là aussi, on n’était pas très bien formé à l’utilisation de la fumure organique si bien qu’on avait affaire à un autre type de problème. Il s’agissait d’une herbe qui poussait et qui envahissait nos cultures. On était découragé jusqu’à ce qu’on apprenne à faire le compost. Avec le compostage, on détruit les mauvaises graines et petit à petit, nous avons acquis des pratiques agroécologiques. C’est à partir de 2010 que nous avons décidé de pratiquer l’agriculture biologique.
Combien de sites de production dispose l’association ?
L’association a trois sites à son actif. Il y a le site de Bendogo qui est notre siège et nous sommes une quarantaine de femmes à œuvrer dans l’agroécologie.
Le second site se trouve à Gampèla où une quarantaine de femmes s’y trouvent.
Le troisième site se trouve au sein de l’Institut panafricain pour le Développement-Afrique de l’Ouest et Sahel (IPD/AOS) où une quarantaine de femmes également s’y trouvent.

Vous intervenez aussi dans la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et la santé sexuelle et reproductive des femmes. Quelles sont les actions qui ont été menées dans ce sens ?
Au début, nos critères de sélection étaient les femmes en âge de procréer. Donc, il a fallu faire des sensibilisations, des formations sur la santé de la reproduction, sur la planification familiale, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur l’hygiène en général.
Nous avons aussi des jeunes filles qui sont là. Donc, cette sensibilisation en matière de la reproduction continue. Nous les orientons tout le temps vers les centres de santé pour qu’elles aillent faire des dépistages. Ce qui est normal parce qu’il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler.
Quels sont les défis auxquels vous faites face en ce moment ?
Nous travaillons pour le respect du droit socio-économique de la femme. C’est un défi pour nous. Concernant l’agroécologie, nous faisons du bio. Donc, nous avons dit non aux produits chimiques.
Par conséquent, nous sommes en train de voir les éléments qu’il faut pour les plantes et pour cela il faut, la recherche.
Le siège de notre site est dans un bas-fond et pendant l’hivernage, nous ne pouvons pas produire comme en saison sèche.
Nous faisons face aussi aux difficultés du moment. C’est-à-dire l’insécurité. Nous sommes à la limite de la ville et il y a des déplacées internes. Le défi, c’est de trouver de la place pour ces déplacées. La question foncière est également un défi.
Quelles sont vos perspectives ?
C’est de pouvoir aider un plus grand nombre de femmes. Nous cherchons d’autres sites pour étendre notre activité.
Marie Sorgho et Nafissatou Koné