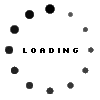Entre la débrouille, l’art et la mode, elle tente d’imposer son talent. Titulaire d’un certificat d’apprentissage délivré par le syndicat national des couturiers et tailleurs du Togo en 1996, cette femme de 39 ans née à Kara voit en la couture une occasion de se frayer un chemin dans l’entreprenariat. Yorouba camerounais, togolais ou béninois, les marinières, les grand-mères, la broderie, telle est sa spécialité. Dans un décor où les mannequins en plastique donnent vie à cet espace avide de clientes, le bruit des machines se mêle au parfum des produits de beauté. C’est ici qu’Amina Oumarou épouse Affo nous reçoit.
Pourquoi devenir une couturière?
(Sourire aux lèvres)! Déjà, quand j’étais enfant, j’utilisais des morceaux de tissus que je coupais avec une lame. Puis, je les cousais à la main. Je créais aussi les modèles. C’est comme ça que je suis venue à la couture.
Quand j’ai grandi, j’ai décidé d’aller voir un monsieur et lui dire que mon père souhaite qu’il m’aide à trouver quelque chose à faire en couture. Il m’a demandée le lieu et j’ai choisi la première école que j’ai vue. Lorsque mon père est rentré du Gabon, il est parti signer un contrat d’apprentissage de trois ans pour moi et il est reparti. Il m’a envoyée l’argent par la suite. Au bout de deux ans, j’ai passé le test et j’ai été deuxième sur 320 apprenants avec la mention très bien, spécialité couture dame.
J’ai rejoint mon mari au Burkina Faso en 2003. Nous n’avions pas où dormir. Il m’a logée chez quelqu’un. Comme j’étais venue avec un peu d’argent, nous avons loué une maison. C’est mon mari qui se promenait dans les ateliers de couture pour me chercher du boulot. Vraiment, ce n’était pas du tout facile.
Parlez-nous de votre parcours professionnel !
A chaque fois, on me dit : « On veut vous donner du travail. Mais, à cause du bébé-là, on ne peut pas. Ou bien, vous trouvez une bonne et vous le laisser avec elle avant de venir. »
C’était comme ça tout le temps jusqu’au jour où une dame a accepté de m’embaucher. J’ai cousu au moins trois complets chez elle. Le jour où elle devait me payer, elle m’a donnée une jupe à faire. Pendant que je traçais les mesures, elle a arraché la craie de ma main et l’a jetée à terre.
Comme ça ! Sans raison. Elle ne m’a pas non plus payée mon salaire. J’étais sans argent et sans travail. J’ai pris mon enfant, je l’ai mis au dos et je suis rentrée. Je n’avais que 125 FCFA avec lesquels j’ai payé du riz pour mon enfant. J’étais tellement découragée qu’arrivée à la maison, j’ai pleuré de toutes mes forces.
Quelques jours après, j’ai trouvé un nouveau boulot chez une autre dame. Elle m’a donné un pagne à coudre. Quand j’ai fini, elle m’a dit : « C’est très bien. Tu peux travailler avec moi. Mais, il faut d’abord que tu trouves une bonne pour ton enfant avant de commencer.» Comme je n’ai pas l’argent pour prendre une bonne, je ne suis plus repartie.
Une autre fois, une consœur béninoise m’a rencontrée et elle m’a dit de venir travailler avec elle. Elle coud à domicile.
J’ai accepté. Souvent, il n’y a rien à faire. Parfois, je vois bien qu’il y a beaucoup à faire. Mais, elle insiste qu’il n’y a rien à faire. Tout ça, pour que je ne touche pas aux pagnes. Surtout, à la fin du mois, pour qu’elle me paye mon salaire, c’est tout un problème. J’ai cessé de travailler avec elle.
Je me suis dite « Comme j’ai une machine au Togo, pourquoi ne pas la faire venir et l’utiliser?»
Mon mari m’a donc trouvée de l’argent pour le transport. J’ai commencé à coudre les habits petit à petit à la maison jusqu’au jour où j’ai croisé une dame qui vend des coupons de pagnes.
J’ai négocié avec elle pour les prendre à crédit et coudre en habits qu’elle me rachète. Cela me faisait de petits sous. Et à un moment donné, j’arrivais à payer les pagnes un à un. Je couds et chaque samedi et dimanche, je me promène pour les vendre. C’est ainsi que j’ai pu mettre l’argent de côté et pouvoir ouvrir mon propre atelier en 2007.
Je vends aussi des accessoires de mode venus du Togo, du Ghana, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.
Depuis que l’atelier fonctionne, qu’avez-vous pu réaliser et qui fait votre fierté?
(Rires). J’ai pu payer des machines, j’en ai quatre maintenant. J’ai également un atelier qui existe à mes frais. En famille, je participe aux charges.
C’est mon père qui m’a donnée ma première machine. Et même si aujourd’hui, j’ai pu en acheter d’autres, je l’utilise encore et je la chéris comme le premier jour où je l’ai reçue. Elle représente pour moi, la bénédiction de mon père et le soutien inconditionnel de mon mari.
Françoise Tougry Ouedraogo