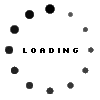À 26 ans, la Soudanaise Mayada Adil, réfugiée politique en France, se sert de la mode pour exprimer son engagement féministe.
C’est un parcours singulier que celui de Mayada Adil. Cette jeune femme au visage rieur a vu sa vie changer du tout au tout en novembre 2018, deux jours avant de quitter Khartoum pour Paris.
À l’époque, la révolution n’a pas encore éclaté dans la capitale soudanaise, mais la colère gronde déjà. « J’étais en pleine rue, en train de parler à un ami, quand un officier de police m’a agressée parce que je ne portais pas mon hijab et que j’avais un piercing au nez. Il a attrapé ma blouse blanche et a essayé de me mettre la main au visage. J’ai, bien entendu, fini au poste, où j’ai voulu porter plainte. »
Médecin, créatrice de mode et mannequin
Mais là-bas, les agents du National Intelligence and Security Service (Niss) connaissent son nom. Elle est médecin dans les camps des Sud-Soudanais situés à Khartoum et dans la ville de Kosti pour le compte de l’Organisation mondiale de la santé.
Elle est aussi créatrice de mode et voyage bien trop souvent, à leur goût, notamment au Kenya, où elle est parfois mannequin. « Ils avaient énormément d’informations sur moi. J’ai laissé tomber la plainte. J’ai eu peur, le jour de mon départ pour la France, qu’ils ne débarquent à l’aéroport pour m’arrêter. Peu après mon arrivée sur le sol français, la révolution a éclaté. J’ai su que je ne pouvais plus rentrer au Soudan, je suis restée. »
Née à Khartoum, Mayada Adil a 7 ans lorsqu’elle doit rejoindre son père, agent de police qui, en 1989, s’est exilé en Arabie saoudite après le coup d’État du général Omar el-Béchir et l’instauration d’un régime militaire.
« Avec ma mère, ancienne employée aéroportuaire, mon frère et ma sœur, j’ai grandi en Arabie saoudite jusqu’à l’âge de 18 ans. » Petite, elle était fascinée par les défilés de mode, partageait la passion des textiles avec sa mère et réalisait déjà ses propres croquis de créations.

Mutilations génitales
En 2011, son pays a été coupé en deux après l’indépendance du Soudan du Sud. « Quand nous sommes rentrés, je n’ai pas reconnu Khartoum. Mes voisins originaires du Sud, avec qui j’avais joué petite, étaient tous partis. C’était franchement bizarre. »
Étudiante en médecine au sein de la National Ribat University, elle se spécialise en gynécologie dans la perspective de travailler pour des organisations humanitaires. « Je me suis spécialisée sur la question des mutilations génitales dans les villages excentrés, mais aussi dans les camps de réfugiés qui ont échappé à la guerre civile au Soudan du Sud.
À Khartoum, je me suis particulièrement rapprochée de trois femmes qui m’ont appris l’artisanat traditionnel en matière d’accessoires et de bijoux. Je leur parlais des collections de ma marque, Mayada, sur lesquelles je travaillais, et j’ai voulu collaborer avec elle », se souvient cette passionnée de mode et fervente féministe.
« En 2019, j’étais en France, mais mon cœur était au Soudan. J’ai suivi chaque étape de la révolution. Et notamment parce qu’elle était menée par des femmes et que longtemps nous avons été les victimes d’un système oppressif. »
C’est en 2017 qu’elle crée sa première collection, Nubian Queen, dédiée aux femmes soudanaises. « J’ai dû la confectionner au Kenya. Je voulais rappeler aux Soudanaises l’héritage que les reines nubiennes, comme Amanishakhéto, leur ont laissé : énergie, force, élégance et majesté. » Les retours ne sont guère positifs : « Ce n’est pas dans nos traditions ni dans nos coutumes ; ce n’est pas comme ça que l’on s’habille », lui dit-on.
Dans le cadre de l’Africa Fashion Reception, initiative de l’Unesco, elle présente en novembre 2019 sa deuxième collection de vêtements et d’accessoires, Sudan and South Sudan, qui porte l’idée d’unifier les deux pays à travers une collection de sept pièces en satin, en laine, en coton ou en textiles traditionnels agrémentés d’objets du quotidien.
« J’ai beaucoup travaillé sur les couleurs. À l’époque de l’occupation anglaise, les femmes portaient des tenues blanches qui étaient synonymes de résistance. Après l’indépendance, elles ont porté du bleu, qui signifiait joie et liberté. Le blanc que portaient les femmes pendant la révolution de 2019 avait le même sens. Mais le bleu était, cette fois, synonyme de tristesse pour les martyrs de cette révolution. »
Aujourd’hui, la jeune femme suit une classe préparatoire aux Beaux-Arts de Paris tout en mettant sur pied ses propres projets. Elle prépare notamment une nouvelle collection avec deux autres réfugiés, somalien et tchadien, par le biais de l’association L’Atelier des artistes en exil. « La mode elle-même est politique », dit-elle.