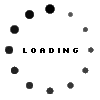Elles sont la principale source de revenus de leur famille. A Ouagadougou, notamment dans les quartiers périphériques, nombreuses sont ces femmes qui « portent la culotte ». Avec un revenu faible gagné à travers divers petits boulots, elles se débrouillent pour assurer leur survie, celle de leur époux et de leurs enfants. Zoom sur ces amazones de l’ombre.
Pelle à la main, Mariam Sawadogo, habitante de Kamboinsin (un quartier périphérique de Ouagadougou), décharge du sable de sa charrette. D’un geste rapide, elle passe de la charrette à la motte de sable. Cette tâche, dame Sawadogo l’effectue depuis 14 ans. Chaque matin aux environs de 5 heures, assise sur sa charrette tirée par un âne, elle va ramasser du sable, ou du gravillon pour le vendre. « Pendant deux ans, j’ai ramassé le sable à la main, sans âne. C’est après que j’ai pu avoir un âne pour me faciliter la tâche », note-t-elle. Après deux ou trois aller-retour, la quinquagénaire rentre chez elle pour prendre une barrique et des bidons. Elle va ensuite puiser de l’eau à la fontaine pour le revendre aux ménages ou aux maçons. En plus de ces travaux, elle est aussi lingère. « Samedi et dimanche, les gens sont à la maison, donc je passe proposer mes services ». A 50 ans, Mariam Sawadogo se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille, sans jamais de répit.

A l’instar de Mariam, sa voisine Sylvie Ouédraogo, mère de six enfants assure également la survie de sa famille. Pour y parvenir, cette femme de 47 ans mène diverses activités telles que : l’élevage, l’agriculture ainsi que la vente d’eau et de terre. Avec pour seule arme son courage, dame Ouédraogo s’efforce de joindre les deux bouts avec ses multiples tâches.
Une autre femme rencontrée au quartier Kossoghin de Ouagadougou se trouve dans le même cas que Mariam et Sylvie. Agée de 36 ans, Zénabo Compaoré est mariée et mère de 04 enfants. Pour assurer le pain, les soins ainsi que la scolarité de ses enfants, la jeune dame fait du commerce. « Le matin je vends bourmassa (des gâteaux) devant la porte et le soir je tourne dans le quartier pour vendre des pagnes, de l’encens, des bijoux, des sous-vêtements, etc. ».
Ce commerce, Zénabo le doit à sa sœur aînée enseignante dans un lycée en province. « C’est grâce à ma grande sœur que j’ai pu avoir l’argent pour faire le commerce. C’est elle aussi qui m’a donné ce vélo », dit-elle montrant une bicyclette bleue sur laquelle est attachée un panier qui lui sert de boutique mobile.

« La seule chose qu’il fait pour nous, c’est nous laisser rester dans sa cour »
Ces femmes mariées, qui sont la principale source de revenus de leurs foyers sont de plus en plus nombreuses à Ouagadougou. « C’est dur mais je n’ai pas d’autres choix que de persévérer. Avant mon mari et moi, on s’entraidait pour les dépenses du foyer mais aujourd’hui, avec le poids de l’âge, il n’arrive plus à travailler », confie Sylvie Ouédraogo.
Le mari de Zénabo, au chômage depuis près de deux ans peine à trouver un emploi stable . « Souvent il peut passer une semaine ou deux sans travailler ; quand il gagne aussi, ça ne suffit pas pour tous nous nourrir », se lamente la jeune femme. C’est donc grâce à son commerce que Zénabo Compaoré arrive à gérer les besoins de sa famille.
Lire aussi: Covid-19 : le ministère de la solidarité nationale vole au secours des ménages vulnérables
Si certains hommes n’ont pas le choix, vieillesse ou maladie oblige, d’autres par contre ont démissionné totalement de leur rôle d’époux et de chef de famille.
Polygame, le mari de Mariam Sawadogo, refuse catégoriquement de subvenir à ses besoins et à ceux de leurs 06 enfants. « Même leur scolarité, il ne paye pas. Leurs repas, leurs soins et tout le reste, c’est moi qui m’en charge. La seule chose qu’il fait pour nous, c’est nous laisser rester dans sa cour », déplore-t-elle la voix tremblante.
« On constate malheureusement dans la ville de Ouagadougou et dans d’autres villes de la sous-région des femmes qui se lèvent très tôt le matin, vont au marché, se saignent et travaillent dur pour trouver juste de quoi subvenir aux besoins de leurs familles tandis que l’homme ne fait rien. Il est fainéant et au lieu d’être un appui pour son épouse, il est plutôt une charge. », indique Aboubakar Seoné, un enseignant en science islamique.
Selon Dr Marie Thérèse Arcens-Somé, chercheure à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) qui a consacré sa thèse aux stratégies de survie en milieu défavorisé dans la ville de Ouagadougou, ce sont les femmes qui se battent pour faire vivre le ménage et s’occuper des enfants dans les ménages vulnérables.
« Les femmes s’occupent des enfants, s’humilient pour aller demander de l’aide afin de payer leurs scolarités, font des petits commerces, des petits boulots, etc. », a révélé la sociologue.
Au cours de ses recherches dans les familles, une femme a expliqué au Dr Arcens que son mari estime qu’après avoir mis à leur disposition la maison, il a fait sa part. C’est donc à elle de se battre pour s’occuper de l’éducation des enfants : « La femme m’a dit qu’à 4 heures du matin, elle va à l’hôpital pour faire le ménage. A 7 heures, elle revient se reposer puis à 9 heures, elle reprend le tissage de pagne (elle est tisserande) ».

La place de la femme est cachée
Si la contribution des femmes dans la survie des ménages vulnérables à Ouagadougou est indéniable, elle reste tout de même cachée. Du fait de l’éducation reçue (la soumission à son époux), la femme mettra toujours l’homme en avant, faisant croire que c’est grâce à lui qu’elle a tout.
On estime que dans les familles démunies, la femme supporte à elle seule 75% des charges de la famille.
La femme a beau « porter la culotte » sur le plan financier, elle n’est pas considérée comme chef de ménage. Le « zacksoba » (littéralement traduit par le propriétaire de la cour) conserve son titre de chef de ménage. Les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2006 démontrent davantage la place cachée de la femme burkinabè dans le ménage. A Ouagadougou, par exemple, il n y a que 14% de femmes chefs de ménage (veuves, mères célibataires, femmes vivant en couple, etc.), la moyenne nationale étant de 11%. Seulement 1,3 % des femmes burkinabè ayant un conjoint vivant ont été recensées comme chefs de leur ménage.

La déchéance d’une société
La situation difficile que vivent les femmes dans les ménages pauvres est perceptible partout dans la ville de Ouagadougou. Le balayage des rues, le ramassage de cailloux ou de sable dans les rues pour les revendre, la lessive dans les ménages et même la mendicité sont des activités qu’elles mènent pour nourrir les enfants et leur époux. Ce sont là des activités que bien des hommes n’accepteraient faire même au nom de la survie de leur famille. Pire, Quand ça chauffe, l’homme sauve sa peau en abandonnant femme et enfant.
Pourtant selon nos sociétés traditionnelles, il revient à l’homme de subvenir aux besoins du ménage, nous renseigne le Baloum Naaba de Kassa. « Traditionnellement, c’est l’homme qui assume toutes les charges de la famille. Tant qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure comme un décès ou la folie, la femme n’a pas à prendre cette responsabilité », a-t-il expliqué.
Le premier ministre du chef de Kassa assure que ce n’est dans aucune tradition au Burkina qu’un homme soit à la charge de sa femme : « à mon avis, ce phénomène est importé. Quel que soit l’ethnie qu’on prend au Burkina ici, ça ne fait pas partie de sa tradition. ».
Noufou Ilboudo, un septuagénaire, habitant au quartier Tanghin de Ouagadougou, relativise les propos du Baloum Naba : « Une femme peut subvenir aux besoins du ménage si son mari n’a rien. C’est mieux qu’une femme gère le foyer plutôt que de laisser son mari qui n’a pas de travail aller voler et se faire battre à mort. Il n’y a pas de honte à ce que ce soit la femme qui assure les dépenses dans la maison ».

Le changement viendra des femmes
Le constat est là : ce phénomène prend de l’ampleur et augmente la situation de vulnérabilité des femmes. Un changement s’impose.
Pour mettre fin à cette situation, le Baloum Naaba de Kassa insiste sur deux points : l’éducation et l’institution du mariage. « Il faut revoir l’éducation et redonner au mariage qui est une institution sacrée sa vraie place », mentionne-t-il.
Du point de vue du Dr Arcens, par ailleurs actuelle directrice générale du fonds national pour l’éducation et la recherche (FONER), la situation des femmes est culturelle et sociale donc elle ne peut pas changer en un an mais par génération. C’est pourquoi elle préconise que l’on permette aux filles d’atteindre au moins le baccalauréat. La sociologue rappelle aussi que le changement viendra du comportement des mamans et des tantes. Estimant que les filles imitent les comportements de leurs mères, le Dr Arcens exhorte donc ces dernières à donner l’exemple et à communiquer avec leurs progénitures. « Les enfants grandissent et sont éduqués à travers l’exemple qu’on leur donne », affirme-t-elle.
Le mariage « oui » mais l’indépendance financière d’abord !
Au regard de la situation pénible qu’elles vivent, certaines femmes se battent pour éviter le même sort à leur fillette. Pour Mariam Sawadogo, Sylvie Ouédraogo et Zénabo Compaoré, une chose est claire : elles n’accepteront pas que leurs filles se marient avant d’être indépendante financièrement.
« Je n’ai qu’une fille mais je lui répète chaque fois qu’elle doit faire tout son possible afin de réussir à l’école pour avoir un bon emploi un jour. Le mariage n’est pas tout dans la vie », soutient Zénabo Compaoré. « Si aujourd’hui, on court de gauche à droite pour chercher de quoi survivre, c’est parce qu’étant jeunes, on se disait qu’une femme c’est le foyer. Son mari subviendra à ses besoins.», Tant qu’elles ne travaillent pas, ce n’est pas la peine de penser à se marier. », explique Sylvie Ouédraogo.
Même son de cloche chez Mariam Sawadogo « Ma situation actuelle doit servir de leçon à mes enfants parce que balayer la terre pour survivre ce n’est pas une vie. Les hommes n’entretiennent plus leurs femmes donc que chacune grouille se trouver un boulot qui va lui permettre de s’occuper d’elle-même ».
Mariam, Zenabo et Sylvie aspirent à de meilleures conditions de vies mais elles manquent de moyens financiers. Si Mariam souhaite faire du commerce, Sylvie, elle, veut s’investir dans l’élevage. Zénabo, désire ouvrir sa propre boutique de vêtements pour femmes et enfants. En attendant de trouver ces moyens, elles continuent à ramasser le sable, à puiser de l’eau, à lessiver, à vendre des gâteaux, bref à essayer de survivre comme elles peuvent.
Faridah DICKO