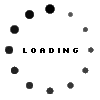Cet article de vulgarisation est tiré de l’article «Recherche participative pour développer la filière de l’igname au Burkina Faso : Enrôlement des acteurs et place des chercheurs du projet
YAMSYS» publié dans le numéro 67 de la Revue Africaniste Inter-Disciplinaire – RAID. La co-construction pousse à redéfinir le rôle et la place de chaque acteur impliqué dans le processus. Cet article présente l’appréhension des producteurs expérimentateurs du processus de co-construction des connaissances alternatives de gestion intégrée de la fertilité des sols sous culture igname.
Mots clés : chercheurs, producteurs expérimentateurs, co-construction, igname
Introduction
L’objectif du sommet mondial pour l’alimentation de 1996 était de « réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde d’ici 2015 ». Cependant, ceci reste une utopie dans les pays d’Afrique Subsaharienne. Au Burkina Faso, la vulnérabilité des producteurs agricoles s’observe au travers des contraintes multiples. Les producteurs d’ignames sont, de plus en plus confrontés à la pression foncière, la rareté et la qualité des semences, le manque de débouchés pour une commercialisation rentable, le désengagement de l’État qui classe cette culture vivrière dans la catégorie « autres cultures », sans omettre les aléas pluviométrique, la prédominance de technologies agropastorales arriérées, le manque d’encadrement et d’accompagnement des producteurs.
Le producteur d’igname est de nos jours, demandeur de pratiques nouvelles afin d’induire des changements dans le système de production à base d’igname. Plusieurs travaux révèlent l’efficacité et la rentabilité des paquets technologiques mis en œuvre par la recherche, cependant leur taux d’adoption resté faible.
Pour éviter un formalisme qui étouffe les désirs d’apprendre ensemble (co-conception) et d’appropriation des résultats de l’apprentissage, la recherche a repensé ses méthodes (Chia, 2004). C’est ainsi que récemment on assiste au développement de la démarche de recherche en partenariat, visant à combler les lacunes du modèle diffusionniste, en faisant des producteurs des acteurs de la recherche de solutions à leurs préoccupations. L’introduction de la co-construction dans le système agricole, est devenue une voie prometteuse, en agriculture, pour élaborer des propositions en adéquation technique, économique et organisationnelle avec les attentes et les possibilités des agriculteurs (Vall et al, 2016).
L’objectif principal de la co-construction est de générer avec les producteurs des connaissances et des apprentissages qui puissent induire de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques techniques, de nouveaux produits. Quelle perception les producteurs expérimentateurs ont-ils du processus de co-construction ?
Méthodologie
Dans le but d’appréhender la perception des producteurs-expérimentateurs du concept de co-construction, des discussions de groupes ont été organisées dans cinq villages de la commune de Léo bénéficiaires du projet YAMSYS que sont Outoulou, Nadion, Bénaverou, Onliassan et Hélé. Le genre a été un des critères de constitution des groupes de discussion. Ce choix a été motivé par le fait que le projet a initié, en 2018, l’intégration des femmes dans la culture de l’igname à Léo. L’effectif des groupes a varié de cinq à dix producteurs. Les discussions ont porté sur la perception de la co-construction par les producteurs, la description de son processus dans le cadre du projet YAMSYS, les avantages, inconvénients et difficultés dudit processus.
Résultat
Selon les «producteurs champions» la co-construction se traduit en langue sissala par «Lakawôli » et en nuni par « nin-marô » qui signifient « les membres d’une même famille ». Pour ces derniers, la co-construction signifie « donner » et « prendre » ou encore se « réunir » et « échanger ». Ce concept désigne également, pour les producteurs, l’entente et le respect dans l’accomplissement d’un travail d’équipe. Ils expliquent que le bon fonctionnement de l’équipe exige l’existence d’un organe de gestion pour conduire les travaux dans l’optique de l’atteinte des objectifs communs sans une imposition des actions des uns sur les autres. Dans ce travail d’ensemble, ils estiment qu’il revient aux chercheurs, de leur octroyer les paquets techniques, et aux producteurs de les appliquer afin de procéder à une évaluation des résultats entre et par les deux parties. « YAMSYS est venu nous rencontrer dans un premier temps ce qui lui a permis de savoir notre façon de produire l’igname, puis il est revenu avec de nouvelles connaissances pour nous aider », selon 03. Z.M. Les producteurs perçoivent le processus de leur implication et l’implication de leur ressource, la terre, comme des éléments importants de la réussite du projet. Pour Z.S. « Nous nous sommes sacrifiés et nous avons sacrifié une partie de notre terre pour apprendre la confection de petites de buttes afin de produire des semences d’igname, la plantation des boutures, le tuteurage, l’apport d’engrais… ».
Au début du processus de transmission des paquets technique par YAMSYS, les producteurs affirment avoir partagé les connaissances sur leurs pratiques, aujourd’hui supposées anciennes par les initiateurs du projet. De plus, leur implication dans les activités du projet, les a motivé à adhérer au processus comme expérimentateurs volontaires.
Photo 1 : Groupe de discussion avec des producteurs champions de Bénaverou
Source : Y. Florence OUATTARA, août 2020
Les producteurs pensent retrouver certaines de leurs anciennes pratiques parmi les paquets techniques de YAMSYS, ce qui les persuade encore plus qu’il s’agit d’une co-construction. Néanmoins, ils soulignent que les insuffisances relevées dans leurs « anciennes pratiques » n’ont pas fait objet d’un retour d’informations de la part de l’équipe du projet. De plus, ils ont expérimenté plusieurs protocoles de culture et ils participent quasiment pas aux séances de discussion sur les résultats. Selon 03. D.B.,
« Ils sont venus nous montrer des techniques. Nous les avons appliquées, mais les chercheurs devraient revenir vers nous pour que nous évaluons ensemble les pratiques pour voir ensemble ce qu’il faut garder comme bonne pratique et ce qu’il faut améliorer mais rien de cela n’est fait. Ils nous envoient plusieurs étudiants dans nos champs, ils viennent faire des mesures, quand nous récoltons ils sont encore là pour peser les ignames mais les chercheurs ne reviennent plus. Ils ont leurs résultats ils sont contents,….je me demande si la co-construction intéresse toujours chez les chercheurs». Ainsi, pour eux, YAMSYS s’intéresse seulement à ses résultats de recherche.
Du fait que l’équipe de recherche ne procède pas avec les expérimentateurs à des discussions sur les résultats obtenus, les producteurs ont le sentiment d’être dans un processus d’expérimentation sans fin d’une part et d’autre part, de non considération de leur point de vue. De l’avis de 03.D.L. « Ce que YAMSYS nous dit de faire on le fait pourtant ce que nous, nous disons à YAMSYS d’expérimenter il ne le fait pas, je pense que dans la co-construction le chercheur doit aussi respecter les propositions du producteur». De plus, ces producteurs ont le sentiment d’être des outils que le chercheur manipule à chaque fois qu’il en a besoin. Conjugué à la non prise en compte de leurs savoirs et de leurs droits de paroles, le processus d’expérimentation qui devrait induire une forte diffusion des connaissances et une adoption à grande échelle des paquets techniques par les producteurs d’igname se trouve être confronté par un désistement progressif des producteurs.
Nonobstant, la co-construction a brisé des barrières entre les producteurs et les « fonctionnaires » comme les agents de l’environnement qui étaient perçus comme des acteurs inaccessibles dans la culture de l’igname. « La co-construction a permis d’avoir des relations avec d’autres personnes, de se rapprocher des personnes que nous craignions, comme les agents de l’environnement et la police. À force d’échanger sur nos difficultés dans la culture de l’igname, cela a brisé la barrière qui existait entre nous », a relevé 02. N.G., un producteur expérimentateur.
La co-construction a également permis aux producteurs d’essayer les techniques agronomiques avant de prendre la décision de les adopter, de les adapter ou de les rejeter. Elle a renforcé la capacité de production de connaissances actionnables des producteurs ainsi que leurs stratégies d’apprentissages. Le groupe de «producteurs expérimentateurs» est devenu un creusé de connaissances et de savoir-faire dans certains villages, puisque certains, parmi eux, ont su tirer profit de ce partenariat d’apprentissage pas à pas et réflexible. Les processus d’échanges entre producteurs et, entre ces derniers avec d’autres types d’acteurs, a entrainé une redéfinition des objectifs et des stratégies d’adaptation dans la culture de l’igname mais aussi de la filière tout entière ; d’où un élargissement du cercle des acteurs qui tient compte des causes des problèmes des producteurs d’ignames, des causes qui se situent à d’autres échelles. Par conséquent ces effets renforcent le fonctionnement et la pérennité des activités de la plateforme d’innovation du système igname.
Conclusion
L’organe de gouvernance du processus de co-construction de YAMSYS comporte des lacunes qui entravent l’induction du changement dans les pratiques des producteurs. L’équipe de recherche a certes exploré le champ des possibles et fait des options pouvant améliorer la productivité de l’igname. Cependant, la non reconnaissance des identités et des pratiques propres à chaque partenaire et, la non valorisation des spécificités dans la filière igname peuvent entraver l’atteinte des résultats escomptés.
Bibliographie
- Chia E., « Principes, méthodes de la recherche en partenariat : une proposition pour la traction animale», in Revue Elev. Med. Veto Pays trop. 2004, 57 (3-4), pp. 233-240.
- Lavigne-Delville P., « Participation paysanne, discours et pratiques. Quelques réflexions sur le texte de J-P. Chauveau »in Bulletin de l’APAD, 311992, pp. 1-6. Consulté le 04 août 2019. : http://apad.revues.org/381
- Ouattara Y.F., « Recherche participative pour développer la filière de l’igname au Burkina Faso : Enrôlement des acteurs et place des chercheurs du projet YAMSYS », in Revue Africaniste Inter-Disciplinaire – RAID, 67, pp. 163 – 201.
- Vall E., Chia E., Blanchard M., Koutou M., Coulibaly K., Andrieu N., La co-conception en partenariat de systèmes agricoles innovants. In Cahier Agriculture, 25 : 15001, pp. 1-7.