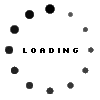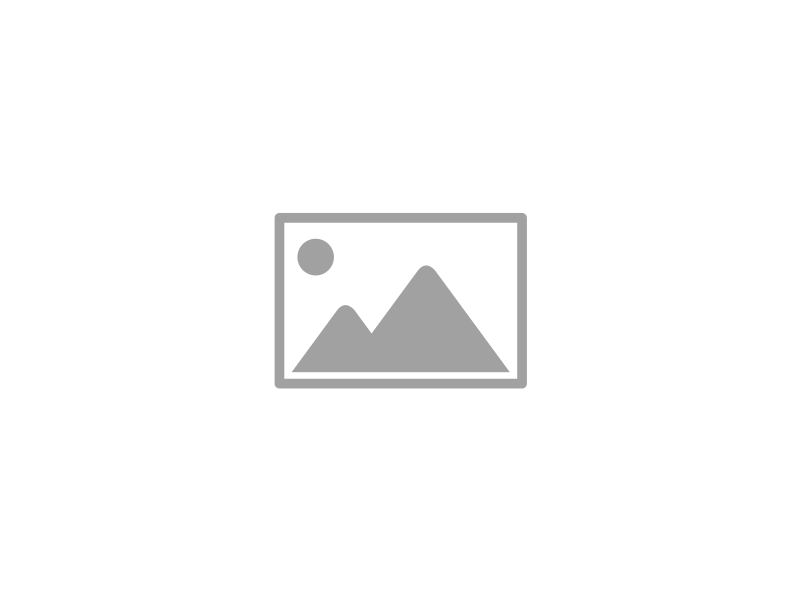La réalisatrice, Delphine Yerbanga, de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), a pris part, du 17 au 21 août 2021, au 16ème Festival des Cinémas d’Afrique de Lausanne. La lauréate du Grand prix du Président du Faso, Meilleur film burkinabè (FESPACO 2021), y a présenté son film documentaire, « Les traces d’un migrant ». Dans l’interview qu’elle nous a accordée, elle fait une appréciation positive sur sa participation au Festival de Lausanne, retrace son parcours personnel, de l’enseignement de la philosophie à la réalisation, etc.
Le Festival des Cinémas d’Afrique de Lausanne est un festival qui fait la promotion des films africains. Je pense que la sélection de mon film pour l’édition 2022 de ce festival constitue un autre tremplin pour moi, pour le renforcement de mon expérience dans la réalisation et le monde du cinéma et de l’audiovisuel. Ça l’est aussi pour le parcours de « Les traces d’un migrant ». Je vis ça comme une chance énorme et un honneur, parce que, bien que le film ait eu un prix, ce n’est pas toujours évident pour le reste du parcours. Il a été sélectionné suite au dépôt de notre candidature à un appel à film. Avec la productrice, nous nous sommes dit qu’il serait intéressant pour nous de pouvoir participer à ce festival qui promeut le cinéma et les réalisateur et réalisatrices africains.
De quoi parle « Les traces d’un migrant » quelle thématique aborde ce film ?
C’est aussi un Festival très connu dans le monde entier et qui connait une très bonne fréquentation. Nous avons, par la suite, reçu une invitation, disant que le film était sélectionné pour être présenté. Je ne peux que m’en réjouir, au regard de ma jeune carrière et des personnalités fabuleuses du monde du cinéma que j’ai pu côtoyer ici. Il existe une collaboration entre le FESPACO et le Festival des cinémas d’Afrique de Lausanne, ce qui favorise les partages d’expériences.
Il s’agit de l’histoire de jumelles qui, dans la quête de leur identité, s’engagent dans un voyage initiatique. Elles entreprennent un long parcours, à la recherche de leur géniteur et par ricochet, de leurs origines. Elles sont accompagnées par leur oncle, le frère cadet de leur père. Si dans le film on voit que l’oncle occupe la première place, porte le premier rôle, il faut dire que tout le déroulement du film part de la quête des jumelles.
J’ai laissé ce rôle central transparaître et l’oncle est présent, aussi bien par sa voix off que par le fait qu’il introduit toujours les échanges entre les jumelles et les autres membres de la famille Ouédraogo. Et selon notre tradition, quand l’oncle qui est un aîné, prend la parole, il le fait au nom des jumelles, qui se mettent sous son couvert. Autrement dit, ce sont les jumelles qui sont les personnages principaux du film.
Le film a été projeté 2 fois à Lausanne. Quel accueil a-t-il reçu ?
En effet, mon film a été projeté deux fois en salle à ce festival des cinémas d’Afrique de Lausanne. J’ai vu qu’il y a eu, en plus des suisses, des occidentaux, des frères burkinabè, africains, qui sont venus le voir. C’était un soutien important pour moi. L’Ambassadeur Représentant Permanent du Burkina Faso à Genève s’est lui-même déplacé pour assister à la première projection. J’en ai été émue. J’ai failli même verser des larmes. J’ai compris que la thématique intéresse actuellement en Europe et dans le monde entier. D’ailleurs plusieurs films de cette édition parlent de la migration.
Mais, mon film parle plus de la migration à l’intérieur de l’Afrique. J’ai vu que le public a bien apprécié et cela me fait chaud au cœur. J’ai reçu beaucoup de questions lors des échanges juste après les projections. Pour moi, c’est un signe de l’intérêt que les uns et les autres ont accordé au film. Les intervenants ont aussi exprimé leur satisfaction d’avoir vu ce film. Moi, en tant que réalisatrice, je suis très comblée.
« Les traces d’un migrant » montre plus le visage de la migration à l’intérieur du continent africain, contrairement à la majorité des production audiovisuelles qui abordent la problématique de la migration. Qu’en dit le publique du festival de Lausanne ?
Quand j’écrivais le scénario et que j’ai commencé à voir les premiers indices du film, j’ai appris que le personnage était passé par le Brésil, dans son périple. Il y a des gens qui m’ont dit, pourquoi ne pas aller dans cet axe ? C’est-à-dire, qu’au lieu de mener l’enquête du Burkina vers le Sénégal et la Guinée Bissau, il y avait aussi la possibilité de tenter le périple du côté du Brésil, pour montrer qu’il y est sans doute allé, en prenant une pirogue ou un bateau, en passant par l’Espagne.

Nous allions surement trouver des gens qui l’ont connu. Mais je me suis dit que cette migration à l’intérieur de l’Afrique, bien que moins connue, moins documentée, est plus importante. Les médias en parlent très peu. Alors que quand on regarde dans chaque famille africaine, il y au moins un ou deux membres qui vivent quelque part, dans un pays africain, mais pas dans leur propre pays. Prenant mon propre exemple, je sais que mon père a fait plus de 30 ans en Côte d’Ivoire. Il y est allé à l’âge de 15 ans et en est revenu quand il avait 45 ans. Nous, on peut le dire ainsi, on est nés quand il était presque vieux. J’ai connu mon père avec les cheveux blancs (rires).
Au Burkina Faso, je crois que la première des destinations, c’est la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal, en gros, les pays voisins. Il n’y a pas si longtemps que les Burkinabè ont commencé à migrer vers l’Occident. Avant, nos ainées y allaient pour des études et ils retournaient chez eux les études terminées. Comparé à d’autres nationalités, ils sont très peu nombreux dans les flux migratoires vers l’Europe, les pays d’Amérique, d’Asie, etc. Le Burkina Faso constitue plus un carrefour de transit vers l’Occident.
La migration qui se déroule à l’intérieur du continent n’est pas source de drames comme ceux vécus en mer, sur les océans ou sur les barbelés à la frontière espagnole
Mais la migration sur laquelle on fait plus de tapage médiatique, c’est celle qui se fait aux portes de l’Occident. J’ai voulu parler de la migration interne à l’Afrique qui, à mon humble avis, est plus importante. Il me semble qu’elle génère le plus important flux de devises, de ressources financières qui font vivre les familles et contribuent au fonctionnement de l’économie. Les migrants ne travaillant pas très loin, il leur est plus facile de renvoyer de l’argent dans leur famille. Mais on n’en parle pas, de mon point de vue. Et je pense que la migration qui se déroule à l’intérieur du continent n’est pas source de drames (comme ceux vécus en mer, sur les océans ou sur les barbelés à la frontière espagnole, par exemple), même si je reconnais qu’il y a des conséquences négatives comme celles que l’on voit avec Abdoulaye.
Certains font des enfants, poursuivent leur route, et n’assument pas. Mais justement, il est temps qu’on en parle, qu’on mette le doigt dessus. Je ne me suis pas inscrite dans une démarche de dénonciation. Mon objectif était de dépeindre une réalité. J’ai voulu, quelque part dire aussi que toutes les migrations n’aboutissent pas à un échec. Il y en a beaucoup qui réussissent. En dehors du fait que le migrant, Abdoulaye, est parti sans donner de nouvelles, il a laissé des descendants, des familles qui agrandissent celle laissée au Burkina Faso. L’humanité d’ailleurs s’est construite et a évolué avec les migrations, les brassages entre les populations.
Comment Delphine Yerbanga est venue à la réalisation ?
C’est une longue histoire (rires). J’ai commencé mes études par la philosophie, à l’université de Ouagadougou. Etudiante, j’étais déjà membre de la fédération des ciné-clubs, avec le cinéaste Guy Désiré Yaméogo. C’est là que j’ai eu mes premiers contacts avec le cinéma en général, le cinéma burkinabè en particulier. Nous visionnions les films, nous les apprécions, nous critiquions, et souvent nous écrivions aussi, parce que nous animions une page de la fédération. Nous faisions des résumés et des commentaires sur les films, nous organisions des séances de projection au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) au ciné-club Sembene Ousmane.
Un des avantages de ma formation au Sénégal, c’est le fait que les enseignants nous encourageaient toujours à saisir toute autre opportunité de formation. Ils nous aidaient même dans la formulation des dossiers pour postuler. Ce fut le cas avec un de nos professeurs, Monsieur Laurent chevalier, un français, qui nous a enseigné notamment la chorégraphie de la caméra. Il m’a encouragée à postuler pour une formation à la Fondation européenne des métiers de l’image et du son (FEMIS), une université d’été à Paris. J’ai ainsi bénéficié d’une autre formation dans cette structure.
Après ce parcours, je suis rentrée au Burkina Faso. J’ai tout de suite décidé de faire la réalisation. J’ai alors engagé mon premier projet de documentaire, « Sur les traces du père » sur lequel je travaillais déjà après mon Master 2 à Saint-Louis. Mais il se trouvait que je n’avais pas de financements. En plus, je n’avais pas un boulot fixe, donc pas de revenu. J’ai commencé à faire des stages sur les plateaux de tournage. Mais, on ne peut pas vivre de ça. Je me suis rappelée que j’avais quand même une licence en philosophie et que je pouvais enseigner avec ça.
J’ai passé cinq ans dans l’enseignement avant d’avoir la chance d’aller à la Radiodiffusion télévision du Burkina RTB-télé pour exercer comme réalisatrice. Depuis, je suis dans la réalisation à temps plein. C’est pendant que j’étais à la RTB-télé que j’ai finalisé mon projet, ce qui a donné le film « Les traces d’un migrant », réalisé en 2020 et présenté au FESPACO 2021.
A LIRE AUSSI: FESPACO 2021 : Khadar Ahmed remporte l’Etalon d’or de Yennenga avec son film « la femme du fossoyeur »
La genèse du film, de la formulation du projet à sa mise en œuvre
Deux jours après, nous sommes repartis chez elles, avec l’aide de Madame Bassolé, qui nous a indiqué leur domicile. Une fois chez elles, nous les avons interviewées pendant une heure. Il est ressorti de leur récit qu’elles avaient perdu leur mère et qu’elles n’avaient pas réellement connu leur père, parce qu’il était parti quand elles étaient encore très jeunes.
Il avait divorcé d’avec leur mère depuis qu’elles étaient encore des nourrissons. Mais il réapparaissait de temps à autre, jusqu’à partir définitivement, quand elles avaient huit ans. Quand je les ai connues, elles avaient 18 ans. Donc dix ans après qu’elles ont commencé à rechercher leur père.
Nous avons commencé à travailler sur ce projet. Cela a coïncidé avec la fin de mes études. Je suis rentrée au Burkina Faso. J’ai commencé à me renseigner, pour savoir où trouver le père, mais le nom de famille ne m’aidait pas beaucoup. Comme on trouve des Ouédraogo dans presque toutes les régions, c’était un peu compliqué. J’étais dans cette impasse quand un jour je reçois un appel de l’ambassade du Burkina Faso au Sénégal, qui me donne le contact de Aboubacar Ouédraogo, un demi-frère des jumelles. Lui aussi s’était lancé dans la recherche de son père.
C’est par ce dernier que j’ai pu entrer en contact avec la famille de Abdoulaye Ouédraogo, à Ouahigouya, région du Nord au Burkina Faso. J’ai d’abord rencontré Alima, une sœur cadette du père recherché, puis ensuite son frère cadet, Idrissa Ouédraogo. Ce dernier avait entamé l’écriture d’un livre sur la vie du frère dont l’intitulé était « La vie d’un émigré ». Nous avons alors décidé de faire route ensemble et d’aller au Sénégal, parce que lui aussi mourrait d’envie de connaître la vérité, de suivre les traces de son frère. Il voulait voir aussi les enfants laissés au Sénégal par son frère.
Du coup, le projet se modifie un peu, à ce niveau. J’opte pour l’intitulé, « Sur les traces d’Abdoulaye », parce qu’il ne s’agissait plus uniquement du père des jumelles, il s’agissait aussi du frère de Idrissa. Nous avons commencé la production du film avec ce titre.
Nous avons mis du temps à obtenir une aide, d’abord pour l’écriture, la production. Le premier financement nous est venu d’une société dénommée STEPS. STEPS est une structure sud-africaine qui avait initié un programme dénommé génération Africa et dont le choix était de travailler sur la thématique de la migration.
Le projet a été soumis à cette structure qui a manifesté de l’intérêt et a décidé de nous accompagner. L’OIF nous a soutenu avec une aide à l’écriture de 10 000 euros. STEPS a supporté tout le budget de la production. C’est comme ça que nous avons quitté le Burkina, avec le frère du migrant, plus un technicien (un ingénieur de son), pour aller rencontrer les jumelles au Sénégal, et ensuite nous embarquer à leur suite pour la Guinée Bissau. C’est vraiment ça qui a permis au film de voir le jour.
A l’issue de cette étape, nous avons reçu une bourse du royaume du Maroc pour la post-production. Une fois le montage fini au Burkina, nous sommes allés au Maroc pour l’étalonnage et le mixage. Nous avons également bénéficié du soutien d’une structure dénommée Fonds pour la jeune création francophone « JCF », un fonds qui soutient les premières et deuxièmes œuvres. Lorsque nous avons fini le montage du film, nous nous sommes rendus compte que l’intitulé « Sur les traces d’Abdoulaye » ne tenait plus.
Ça donnait l’impression qu’il s’agissait d’une enquête, de bout en bout. Alors qu’au-delà de l’enquête, nous avions toutes ces traces laissées par Abdoulaye dans son sillage, notamment, les enfants, tous les fragments de son histoire reconstituée, tous les morceaux recollés. En somme, le titre « Les traces d’un migrant » s’est imposé à nous.
Il y a un travail d’équipe qui sous-tend les qualités techniques du film, qui ont été bien appréciées à Lausanne ici.
Au regard du fait que nous n’avions pas de moyens au départ pour bénéficier des services d’un technicien de prises de vues, les premières images ont été tournées par moi-même et mon professeur Mamadou Sellou Diallo. Notamment la première interview des jumelles, à Dakar, c’est lui qui posait les questions et qui assurait la traduction, vu que moi je ne comprends pas la langue Wolof. Quand je devais repartir à Saint-Louis pour les repérages, j’ai dû demander l’accompagnement d’un technicien de prise de vues parlant la langue des jumelles et qui pouvait être en complicité avec moi. J’ai soumis ma requête à mon professeur, qui m’a recommandé un ancien étudiant de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Omar Bâ. Il est sénégalais.
Ce dernier s’était illustré très positivement dans le domaine de la prise de vues. Il est d’ailleurs actuellement un des meilleurs chefs opérateurs de prise de vues, en matière de documentaire au Sénégal.
Quand je suis allée pour les repérages, nous avons passé trois jours avec les filles, sans filmer, sans poser de caméra. C’est après que nous avons commencé à poser la caméra, d’abord au domicile des jumelles. Puis, nous avons tenté le voyage sur la Guinée Bissau en pirogue. Vous avez sans doute entendu les filles dire dans le film : « l’année précédente, on était dans la pirogue, on rêvait… ».
Nous avons fait ces premiers tournages avec le cadreur, et c’était une façon de nous mettre dans le bain. L’idée c’était aussi d’acquérir une expérience du tournage sur le fleuve. Cela permettait de savoir s’il était adéquat de faire le voyage en pirogue ou par le bateau. Il était évident que nous ne pouvions pas voyager sur l’océan en pirogue pour joindre la Guinée Bissau. Ce test s’est avéré très positif et ce technicien m’a été d’une grande aide, parce que c’est lui qui me servait aussi d’interprète. Comme nous venons de la même école, nous échangions beaucoup sur les aspects techniques. Etant donné que j’avais des connaissances en caméra, je pouvais mieux formuler mes orientations, mes attentes.
Quand j’ai entrepris le tournage proprement dit, nous avons encore travaillé sur le scénario, nous avons arrêté le processus du tournage, le type de plans que je voulais, etc. Avec l’ingénieur de son, nous avons fait le même travail. Et c’est comme ça que nous avons fait tout le périple. Il faut dire que j’ai fait des repérages au Burkina aussi, à Ouahigouya, pour les séquences concernant l’oncle des jumelles. Ce travail, je l’ai fait avec un cadreur de Ouahigouya, Stéphane Uziel Sawadogo, qui a été formé à l’Institut Supérieur de l’Image et du Son-Studio-Ecole (ISIS-SE) de Ouagadougou, au Burkina Faso, et un technicien du son, Soulama Honoré de la RTB.
La démarche visait à mettre l’oncle dans les conditions du tournage, de voir comment il réagissait face à la caméra etc. Dans ce projet, je n’ai pas voulu faire le cadre, parce que je me suis dit que ce n’est pas un projet intimiste. Quand c’est intimiste cela implique qu’il y ait des choses graves que celui qui se confie à la caméra ne veut pas que quelqu’un d’autre entende. Bien au contraire, mes personnages avaient envie de parler, de se faire entendre, pour être aidés dans leur quête. J’ai travaillé avec des techniciens, pour donner aussi plus de forces et de perspectives au film. Parce que quand tu cadres et fais le son en même temps, tu peux manquer de regard critique par rapport à ce que tu filmes.
Si jamais le réel m’offre des perspectives, qui permettent de faire un grand film plus que celui-là, pourquoi pas ?
Les spectateurs, dans la salle, ont relevé les zones d’ombre dans la trame du film. Y’a-t-il d’éventuelles suites du film, eu égard à ces zones d’ombres laissées sur les races de Abdoulaye ?
C’est vrai que le film laisse beaucoup d’ouvertures. On peut toujours aller sur l’axe du Brésil pour y rechercher les traces d’Abdoulaye ou en Côte d’Ivoire ou il a vécu. C’est une autre ouverture en fait. Le Film peut aller dans cette direction, si les moyens permettent de lui donner une suite. C’est vrai, ça peut constituer un tome 2. Mais le risque est que ce soit encore le même film. On n’aura pas une autre dramaturgie. Cela dit, je fais confiance au réel. On peut avoir une grande surprise. Beaucoup de choses peuvent se passer. Du coup, je suis ouverte. Si jamais le réel m’offre des perspectives, qui permettent de faire un grand film plus que celui-là, pourquoi pas ?
Les projets proches ou lointains de Delphine Yerbanga
Actuellement je travaille sur une autre thématique qui est le terrorisme dans mon pays. L’intitulé est pour le moment « L’âme de la Nation ». « L’âme de la Nation » met l’accent sur une préoccupation très partagée au Burkina, celle de l’incivisme. Je viens d’un pays qui a connu un grand homme comme Thomas Sankara, d’un pays qui a composé le Ditanyè, notre Hymne national que nous entonnons fièrement.
Quand j’écoute les paroles de cet hymne, je n’arrive pas à comprendre le comportement de certains de nos compatriotes. Je me demande ce qui s’est passé entre temps, au cours de notre histoire, pour que des burkinabè prennent des armes contre d’autres burkinabè. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans cet hymne et être l’ennemi de notre Nation. La rapacité venue de loin, dont il est question dans l’hymne national et que dénonçait Thomas Sankara, est maintenant à l’intérieur de notre pays. C’est ça que je veux documenter dans mon prochain projet.
De la participation du Burkina Faso au Festival des Cinémas d’Afrique de Lausanne ?
Je suis la seule réalisatrice du Burkina venue présenter un film. Mais vous savez qu’il y a un groupe d’artistes qui a présenté un spectacle Ciné-slam qu’on a appelé symphonie de mots et d’images. C’est un spectacle qui a donné à voir l’historique du cinéma burkinabè, de 1969 à nos jours. Il y a le Délégué Général du FESPACO, Monsieur Moussa Alex SAWADOGO qui conduit la délégation. Il y a le directeur de la cinémathèque africaine de Ouagadougou, Monsieur Léonce TIRA, qui est présent à ce festival.
Le Burkina Faso a été bien représenté à ce Festival. On peut même dire que nous sommes la plus forte délégation, pour ce qui est des participants au Festival, en dehors du Benin qui est le pays invité. J’observe aussi que les burkinabè résidant en Suisse se sont fortement mobilisés pour venir soutenir les membres de la délégation. Je note et je salue particulièrement la présence et le soutien de son excellence Monsieur l’Ambassadeur Représentant Permanent du Burkina Faso à Genève et de ses collaborateurs. Je profite de cette occasion pour lui traduire notre reconnaissance et nos remerciements. Nous remercions aussi l’ensembles des compatriotes et amis du Burkina Faso qui sont venus et qui ont été présents en permanence à nos côtés.
Après ma participation au FESPACO 2021 où le film a reçu le grand prix du Président du Faso, meilleur film burkinabè, j’ai été invitée au Festival Écrans noirs du Cameroun. Le Film est passé à Festival Ciné droit libre à Ouagadougou, au Burkina Faso et à Koudougou.
Au-delà des festivals Delphine Yerbanga a-t-elle vécu d’autres expériences ?
Après ma participation aux événements majeurs que j’ai mentionnés, j’ai été invitée au Japon, pour une résidence d’écriture, organisée par l’UNESCO et le Festival international du film de Nara, organisé par Naomi KAWASE. Naomi KAWASE est une réalisatrice et scénariste japonaise. C’est une femme qui s’est distinguée à travers ses fictions et ses documentaires autobiographiques. Elle a été primée au festival de Cannes. Elle a remporté le Grand prix en 2007, et a été lauréate du prix du jury œcuménique en 2017.
Pendant 20 jours, nous avons été encadrés par Naomi KAWASE et son équipe. Nous étions dix femmes africaines invitées à Nara, pour prendre part à cette résidence d’écriture. A cette occasion, j’ai réalisé un court métrage, genre documentaire, comme toutes les participantes. Mon film était intitulé « Au-delà du rêve humain ». J’ai travaillé sur cette thématique en relation avec mon projet « L’âme de la Nation », parce que le Japon a autre fois souffert des effets pervers de la guerre, notamment la guerre mondiale.
Les séquelles en sont encore très visibles. Malgré tout, on sent que le Japon a pu se relever. Mon pays traverse actuellement une crise sécuritaire. Et, en tant que burkinabè, je me demande, à quand la fin et comment on peut se relever de cette épreuve, après cette fin attendue. Je me suis dit que le Japon, comme le Burkina Faso, a été victime de la folie des hommes. J’ai décidé de mettre les deux réalités en parallèle pour réaliser le court métrage sur le terrorisme, en donnant la parole aux Burkinabè qui résident au Japon. Je leur ai demandé comment les informations leur parviennent ? Comment ils vivent la situation ? Est-ce qu’ils connaissent des gens qui sont tombés ? Est-ce qu’ils ont des parents qui ont été touchés, sachant qu’il y a des déplacés internes, etc.
Le Festival international du film de Nara est actuellement en cours de préparation au Japon. Et si tout se passe comme prévu, nous devons toutes, aller présenter la dizaine de films que nous avons réalisés pendant la résidence d’écriture. Je me prépare aussi pour le Festival International du Film de Femmes de Salé, au Maroc, dans les mois à venir. J’espère que mon film sera retenu pour d’autres festivals.
« Les traces d’un migrant » s’est tourné dans plusieurs pays. Est-ce que les différents protagonistes résidants çà et là ont vu le film depuis sa sortie ?
Les personnages présents au Burkina Faso, lors des projections faites au Burkina Faso ont vu le film. Ils étaient notamment au FESPACO. Le film est mis en ligne sur la plate-forme web de la chaine Arte qui est associé à la production de toute la collection Génération Africa. Nous avons rendu le lien public et le leur avons indiqué. Nous avons prévu d’aller présenter le film, de façon officielle, au Sénégal, et à effet, nous avions prévu de faire une grande première. Elle devait se tenir à Dakar, à l’Institut français et à Saint-Louis. Au moment où nous nous apprêtions, des contraintes de dernière minute nous ont amenés à tout reporter. Nous attendons encore la date probable, en relation avec toutes les institutions impliquées, aussi bien au Burkina Faso, au Sénégal, qu’en Guinée Bissau.
Propos recueillis par Maria Sompougdou