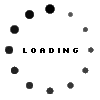« C’était un mercredi. J’avais entre huit et neuf ans », se rappelle Mirah (nom d’emprunt), habitante du quartier Tanghin de Ouagadougou. Plus de vingt ans après, elle s’en souvient comme si c’était hier.
Lorsqu’elle rentre de l’école ce jour-là, la fillette remarque qu’il y a du monde chez elle. Elle est accueillie par sa tante qui lui explique qu’elle ne doit pas pleurer quand elle sera dans la douche (ndlr : c’est là que s’est passée l’excision). « Ma tante m’a dit que toutes les femmes devaient passer par là », grimace-t-elle. Après ce lavage de cerveau, elle est conduite apeurée, dans la douche, où l’attendent ses bourreaux. « Quand je suis rentrée, il y avait quatre personnes dans la douche. Les trois m’ont attrapé, il y a une qui était sur ma poitrine ; les deux autres m’attrapaient les pieds. La dame était sur moi. J’avais tellement peur que je n’ai même pas pleurée », raconte Mirah, la voix rauque.
Zalissa, une autre femme âgée de 27ans, a été mutilée alors qu’elle n’était encore qu’un bébé. Cette habitante du quartier Zogona de Ouagadougou ignorait tout de ce qu’on lui avait fait subir.
Le déclic…

Au collège, après un cours sur la reproduction, la curiosité pousse Zalissa à observer toutes ces parties dont on lui a parlé en classe. Elle découvre alors qu’il lui manque les petites lèvres et le clitoris. Prise de peur, elle en parle à sa grand-mère qui lui révèle qu’elle a été mutilée. Pour la première fois de sa vie, elle se sent incomplète. « Je me sentais mal, j’étais frustrée parce qu’il me manquait quelque chose ».
A l’instar de Zalissa, Mirah a également son déclic après un cours sur la reproduction. « . C’est à partir de là que j’ai commencé à avoir un complexe. »
Pour les deux victimes, la douleur physique est venue s’ajouter à celle psychologique le jour où elles ont perdu leurs virginités. « Quand on a voulu passer à l’acte, ça m’a vraiment traumatisé. La sensation était horrible », explique Mirah. « Quand il met la main sur moi, j’ai l’impression que c’est une lame qu’on est en train de mettre dans ma chair. J’attrapais mon cœur pour lui faire plaisir », poursuit-elle.
Zalissa, elle, l’a vécu comme un choc. « Lors de mon premier rapport sexuel, j’ai eu tellement mal. Après cela je ne voulais même plus voir un homme tant ça m’a choqué ».
Quand grossesse rime avec tourmente
Mariée et mère d’un enfant, Mirah se souvient encore du jour de son accouchement. « J’ai fait plus de 48 h de travail puisque mon col ne se dilatait pas ». Le médecin lui explique alors que l’enfant veut sortir mais qu’il n’y a pas de passage. Il ajoute que les femmes excisées sont les plus exposées à ce genre de complications et qu’elles devaient subir une césarienne pour pouvoir accoucher. « J’ai commencé à pleurer quand il m’a parlé de césarienne. J’étais terrifiée à l’idée de mourir sur la table d’accouchement avec mon enfant », avoue Mirah.
Zalissa, fiancée à l’époque, a accueilli la nouvelle de sa grossesse avec joie : « j’ai entendu parler des complications qui pouvaient survenir mais j’avais foi en Dieu que tout irait bien ». Si elle a pu accouché par voie basse, Zalissa a quand même eu des complications. « Je n’ai pas pu accoucher par moi-même. On m’a déchiré pour que l’enfant puisse sortir », se remémore-t-elle. « Après l’accouchement, elles m’ont recousues mais ça a été mal fait. C’est un gynécologue qui me l’a dit lors d’une visite médicale », relate-t-elle.
Fatoumata Siri, ardente défenseure de la culture et des traditions, fait partie de ceux qui croyaient à une exagération des séquelles de l’excision par les acteurs, dans le but d’avoir des financements de bailleurs de fonds. Son excision a eu lieu en 1990, effectuée dans de « bonnes conditions » par un attaché de santé, ami de la famille avec anesthésie à l’appui. Ni les moqueries de ses camarades d’enfance, ni les témoignages sur les conséquences des mutilations génitales féminines ne l’avaient convaincue jusqu’au jour où elle s’est mariée. « Au début, j’avais des relations sexuelles très douloureuses. Lorsque cela est passé, je croyais être au bout de mes peines. Malheureusement par la suite, j’ai eu un accouchement difficile. Comme je n’arrivais pas à bien pousser, cela a entrainé une souffrance fœtale. Le bébé a dû être réanimé. Cela a duré trois minutes. Mais pour moi c’était une éternité. N’eut été l’intervention du responsable de la clinique qui est un pédiatre expérimenté, mon bébé n’aurait peut-être pas survécu ou aurait gardé des séquelles », a-t-elle confié.
Selon une enquête menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) entre 2001 et 2003 dans 28 centres d’obstétriques au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal et au Soudan, les femmes ayant subi des mutilations génitales féminines ont une probabilité nettement plus élevée de complications obstétricales que celles qui n’en ont pas subi. Sur 28 393 femmes enquêtées, 1760 (6 %) ont été accouchées par césarienne et 1970 (7 %) ont présenté une hémorragie du postpartum. Le nombre de femmes décédées pendant l’hospitalisation s’élève à 45% pour celles qui ont été mutilées.

La sage-femme Sanata Sia peut en témoigner : « Quand vous voyez la femme accoucher, c’est merveilleux. C’est comme si c’est de l’élastique qui s’élargit au fur et à mesure que la tête de l’enfant s’appuie et s’ouvre pour que ça puisse sortir facilement. Par contre la femme excisée perd cette élasticité lors de l’accouchement puisque c’est rétréci », explique-t-elle. Face à une telle situation, les sages-femmes ont recours une épisiotomie afin qu’elle puisse accoucher. Dans le pire des cas, la mère peut perdre son bébé ou y rester.
Marquée à vie
Selon le psychologue Romuald Kaboré, l’une des conséquences fréquentes de ces mutilations reste le complexe d’infériorité. « Psychologiquement, elle ne sent pas comme une femme pleine. L’excision peut venir comme une sorte d’amputation que la femme vit », indique le psychologue.
« Ce sont des souffrances qui restent gravées dans la mémoire pour toute la vie et entachent également la vie de couple de la femme », souligne Romuald Kaboré.

Du fait de ces blocages, certaines sont obligées d’approcher des spécialistes pour trouver des solutions. Au cours d’une consultation, Romuald Kaboré a reçu une dame qui n’a pas pu mener sa grossesse à terme des suites de complications liées à l’excision : « Non seulement, elle se souvient toujours de la souffrance qu’elle a vécue mais il y a aussi chez elle comme un blocage psychologique qui fait qu’elle n’arrive pas à enfanter ». Plus de sept ans après cette grossesse qui s’est mal terminée, le couple n’a toujours pas d’enfants.
« Je veux un clitoris »
Au Burkina Faso, il existe le recours à la chirurgie intime pour reconstruire le clitoris et nombreuses sont les femmes victimes de MGF qui passent par ces interventions. « Chaque année nous avons environ 400 femmes qui viennent consulter ici pour la chirurgie intime », souligne le Pr Charlemagne Ouédraogo, gynécologue obstétricien. La reconstruction du clitoris consiste à repositionner le moignon du clitoris là où il était avant.

Pr Charlemagne Ouédraogo, Gynécologue obstétricien
Selon le Pr Charlemagne Ouédraogo, cette intervention est demandée par les femmes pour diverses raisons : « D’abord, pour des raisons identitaires, la femme a besoin qu’on lui restaure son clitoris, amputé sans son avis ». A celles-ci s’ajoutent des raisons sexuelles.
42 ans révolu, mère de deux enfants mariée à un homme qu’elle décrit comme étant doux et aimant, dame Siri a tout pour être heureuse. Tout sauf une chose : le plaisir sexuel dont parle toujours ses amies reste inaccessible pour elle, même après 13 ans de mariage. De plus en plus, elle pense à une reconstruction du clitoris : « Si jusque-là je n’ai pas franchi le pas, c’est parce que j’avais honte du regard des autres et un peu peur de la réaction de mon époux. Mais à présent, je suis décidée à le faire », a-t-elle fait savoir avant d’ajouter que pour elle, le plaisir sexuel est un droit que chaque femme devrait revendiquer comme tous les autres.
Tout comme Fatoumata, Zalissa souhaite elle aussi avoir une chirurgie réparatrice. « Je veux un clitoris. C’est sûr que ça va améliorer ma vie sexuelle », dit-elle pensive.
Quant à Mirah, elle ne veut pas en entendre parler : « Rien que d’imaginer des gens sur moi avec des instruments me terrifie. Je ne pourrais pas le supporter, ça sera comme revivre ce qu’on m’a infligé ».

Le Burkina Faso est encore loin de l’annihilation des mutilations génitales féminines mais ces quinze dernières années, la tendance est à la baisse et des acquis ont été engrangés. Parmi ces acquis, il y a l’accroissement du nombre de villages et de communautés déclarant l’abandon de la pratique de l’excision ainsi que le renforcement de la prise en charge des survivantes. La prévalence de l’excision qui était estimée à 66% chez les femmes de 15-49 ans en 1996 selon les chiffres de l’INSD, est passé à 11,3% en 2015.
Au regard de l’impact négatif que les mutilations génitales féminines ont sur leurs vies, Zalissa et Mirah sont convaincues d’une chose : jamais, leurs filles ne subiront un tel supplice. Par chance, elles ont survécu à la lame, même si les impacts physiques et psychologiques continuent de les hanter. Combien sont-elles à avoir eu cette chance ? Combien de filles et de femmes devront encore payer de leur vie avant que ce fléau ne prenne fin ?
Faridah DICKO